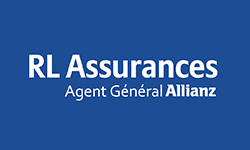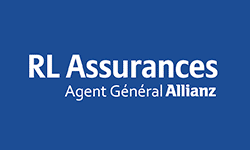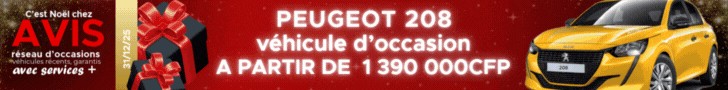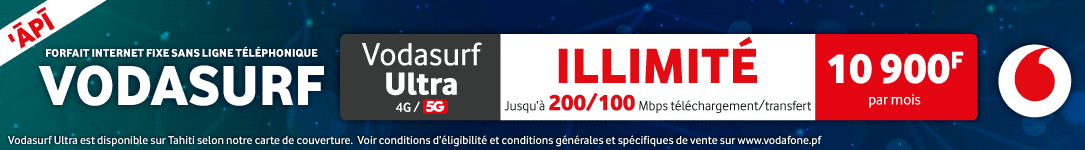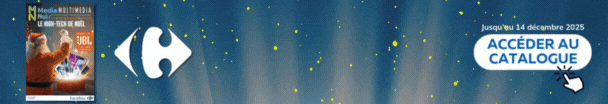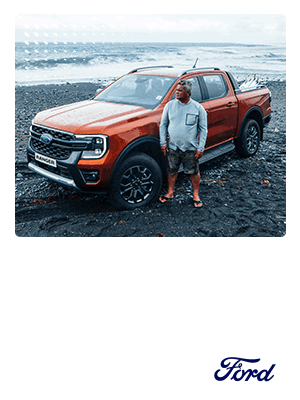Tahiti, le 5 février 2025 - À l'occasion de la 29e journée nationale de prévention du suicide, l'association SOS Suicide recevait ce mercredi le public, et notamment des jeunes, dans le hall de l'assemblée pour les sensibiliser face à ce phénomène qui évolue “dans le mauvais sens”, selon la présidente de l'association Annie Tuheiava Mairau. Enfermés dans leur bulle et sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus jeunes lorsqu’ils passent à l'acte.
Annie Tuheiava Mairau préside l'association SOS Suicide depuis le départ, il y a six ans, de son prédécesseur, le docteur Stéphane Amadeo. Et depuis, elle constate “une évolution dans le mauvais sens”, notamment en raison d'un changement des mentalités chez les jeunes. “Aujourd'hui, tout le monde est branché sur les smartphones, il n'y a plus de discussion possible avec les parents. Les jeunes s'isolent, ils sont livrés à eux-mêmes et ils trouvent des solutions dans les réseaux sociaux. Communiquer, écouter, c'est la base de la prévention. Parce que quand on parle avec quelqu'un, on sent les émotions, soit de la tristesse dans la voix, ou de la colère et là, à ce moment, les parents peuvent agir”, explique-t-elle.
Des parents “impuissants” et “déstabilisés” par ces situations car ils ne prennent pas la mesure de l'isolement dans lequel s'enferment ces jeunes accrochés à leurs téléphones. “Je ne veux pas critiquer les parents mais peut-être que parfois, ça les arrange parce qu'ils sont tranquilles.” Elle insiste donc sur la nécessité de réinstaurer le dialogue au sein du foyer, parce que “si on ne communique pas, on ne peut pas détecter les problèmes”.
Un accompagnement pour les parents endeuillés
La plupart des parents sont en effet stupéfaits et ne comprennent pas pourquoi leur enfant est passé à l'acte. Ils n'ont rien vu venir et se retrouvent du jour au lendemain livrés à eux-mêmes et en proie à la culpabilité. C'est pourquoi l'association a décidé de mettre en place une structure pour accompagner ces familles endeuillées avec l'appui de psychologues. “Il faut appeler le numéro vert (444 767) ou le 87/89 20 25 23. C'est important”, insiste Annie Tuheiava Mairau.
Ce sont souvent des ruptures amoureuses qui sont le déclencheur, explique-t-elle, notamment chez les 15-16 ans. “C'est souvent leur premier amour et ils commencent à s'enfermer dans leur chambre. Ensuite, pendant un jour ou deux, ils ne viennent plus à table et le quatrième jour, on les retrouve sur une corde.” Car en Polynésie, le suicide par pendaison est le plus courant et touche désormais aussi bien les garçons que les filles. “Avant, c’étaient les hommes qui se pendaient, et les filles préféraient plutôt les médicaments, parce qu'elles veulent toujours rester belles. Aujourd'hui, le comportement a changé.”
Drogue, alcool et jeux dangereux
Autre changement plus inquiétant, l'âge des victimes qui a considérablement rajeuni. Si l'essentiel des appels reçus par l'association concernaient des adolescents entre 15 et 20 ans, aujourd'hui, ce sont des enfants de moins de 10 ans qui sont aussi concernés. “Ils sont de plus en plus jeunes. Et ils n'ont pas forcément subi un choc traumatique”, précise Annie Tuheiava Mairau qui n'a pas “vraiment d'explication” si ce n'est qu'ils “sont peut-être malades”.
La faute aussi au contexte familial. Certains enfants commencent à boire de l'alcool à 11 ans ou à fumer du paka encore plus tôt, dès l'âge de 8 ans, comme nous l'a expliqué l'une des “sentinelles de la prévention” installées dans le hall de l'assemblée, Healani Toa, de l'Union polynésienne de la jeunesse (UPJ). (lire encadré)
Ajoutez à cela les jeux dangereux qui se propagent sur les réseaux sociaux et vous avez un cocktail explosif. Jeu du foulard, jeu du sac, “rêve indien”, “blue whale challenge”, et d'autres. Qu'il s'agisse de bloquer sa respiration le plus longtemps possible, de verser de l'alcool sur les yeux ou d'avaler de la lessive, toutes sortes de jeux pullulent sur TikTok, Snapchat, Instagram et YouTube. Une sorte de “cap ou pas cap” qui a pris des proportions dramatiques. “Certains jeunes veulent essayer parce que – on a été ado nous aussi – on imite pour faire comme tout le monde et dire je suis capable”, précise la présidente de l'association qui voit néanmoins aussi l'avantage de ces réseaux pour diffuser des messages de prévention. “On en a besoin mais c'est à double tranchant”, conclut-elle.
Difficile d'avoir des chiffres précis sur le nombre de suicides en Polynésie mais en deux ans, le nombre de tentatives a quasiment doublé et avoisine les 500 par an.
Annie Tuheiava Mairau préside l'association SOS Suicide depuis le départ, il y a six ans, de son prédécesseur, le docteur Stéphane Amadeo. Et depuis, elle constate “une évolution dans le mauvais sens”, notamment en raison d'un changement des mentalités chez les jeunes. “Aujourd'hui, tout le monde est branché sur les smartphones, il n'y a plus de discussion possible avec les parents. Les jeunes s'isolent, ils sont livrés à eux-mêmes et ils trouvent des solutions dans les réseaux sociaux. Communiquer, écouter, c'est la base de la prévention. Parce que quand on parle avec quelqu'un, on sent les émotions, soit de la tristesse dans la voix, ou de la colère et là, à ce moment, les parents peuvent agir”, explique-t-elle.
Des parents “impuissants” et “déstabilisés” par ces situations car ils ne prennent pas la mesure de l'isolement dans lequel s'enferment ces jeunes accrochés à leurs téléphones. “Je ne veux pas critiquer les parents mais peut-être que parfois, ça les arrange parce qu'ils sont tranquilles.” Elle insiste donc sur la nécessité de réinstaurer le dialogue au sein du foyer, parce que “si on ne communique pas, on ne peut pas détecter les problèmes”.
Un accompagnement pour les parents endeuillés
La plupart des parents sont en effet stupéfaits et ne comprennent pas pourquoi leur enfant est passé à l'acte. Ils n'ont rien vu venir et se retrouvent du jour au lendemain livrés à eux-mêmes et en proie à la culpabilité. C'est pourquoi l'association a décidé de mettre en place une structure pour accompagner ces familles endeuillées avec l'appui de psychologues. “Il faut appeler le numéro vert (444 767) ou le 87/89 20 25 23. C'est important”, insiste Annie Tuheiava Mairau.
Ce sont souvent des ruptures amoureuses qui sont le déclencheur, explique-t-elle, notamment chez les 15-16 ans. “C'est souvent leur premier amour et ils commencent à s'enfermer dans leur chambre. Ensuite, pendant un jour ou deux, ils ne viennent plus à table et le quatrième jour, on les retrouve sur une corde.” Car en Polynésie, le suicide par pendaison est le plus courant et touche désormais aussi bien les garçons que les filles. “Avant, c’étaient les hommes qui se pendaient, et les filles préféraient plutôt les médicaments, parce qu'elles veulent toujours rester belles. Aujourd'hui, le comportement a changé.”
Drogue, alcool et jeux dangereux
Autre changement plus inquiétant, l'âge des victimes qui a considérablement rajeuni. Si l'essentiel des appels reçus par l'association concernaient des adolescents entre 15 et 20 ans, aujourd'hui, ce sont des enfants de moins de 10 ans qui sont aussi concernés. “Ils sont de plus en plus jeunes. Et ils n'ont pas forcément subi un choc traumatique”, précise Annie Tuheiava Mairau qui n'a pas “vraiment d'explication” si ce n'est qu'ils “sont peut-être malades”.
La faute aussi au contexte familial. Certains enfants commencent à boire de l'alcool à 11 ans ou à fumer du paka encore plus tôt, dès l'âge de 8 ans, comme nous l'a expliqué l'une des “sentinelles de la prévention” installées dans le hall de l'assemblée, Healani Toa, de l'Union polynésienne de la jeunesse (UPJ). (lire encadré)
Ajoutez à cela les jeux dangereux qui se propagent sur les réseaux sociaux et vous avez un cocktail explosif. Jeu du foulard, jeu du sac, “rêve indien”, “blue whale challenge”, et d'autres. Qu'il s'agisse de bloquer sa respiration le plus longtemps possible, de verser de l'alcool sur les yeux ou d'avaler de la lessive, toutes sortes de jeux pullulent sur TikTok, Snapchat, Instagram et YouTube. Une sorte de “cap ou pas cap” qui a pris des proportions dramatiques. “Certains jeunes veulent essayer parce que – on a été ado nous aussi – on imite pour faire comme tout le monde et dire je suis capable”, précise la présidente de l'association qui voit néanmoins aussi l'avantage de ces réseaux pour diffuser des messages de prévention. “On en a besoin mais c'est à double tranchant”, conclut-elle.
Difficile d'avoir des chiffres précis sur le nombre de suicides en Polynésie mais en deux ans, le nombre de tentatives a quasiment doublé et avoisine les 500 par an.
Healani Toa, 19 ans, engagée service civique dans la brigade promotion santé de l'Union polynésienne de la jeunesse (UPJ) : “Une approche douce auprès du public”
“Notre rôle est de promouvoir la santé. Les thématiques qui ont été retenues concernent l'addiction et la santé mentale. Nous sommes là pour avoir une approche douce auprès du public afin de les informer et de les conseiller. Certaines personnes se nourrissent des addictions pour en finir avec leur vie. Parce qu'ils boivent énormément d'alcool, même jeunes. Ils commencent même très jeunes, c’est-à-dire à l'âge de 11 ans, et vis-à-vis des substances illicites, c'est même encore plus jeune que ça, ils peuvent commencer à partir de 8 ans. (...) Certains jeunes sont plus à l'aise de voir que ce sont des jeunes comme nous qui parlent, mais d'autres sont encore très réservés et on les comprend, c'est tout à fait normal. Les questions qui sont souvent revenues, c'est pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut leur apporter vis-à-vis du grand mot suicide, sachant que c'est un terme très lourd aujourd'hui pour les jeunes. On n'est pas là pour avoir une approche directe vis-à-vis du suicide, mais pour commencer à ouvrir la discussion et attendre que ce soient les jeunes qui s'ouvrent à nous.”