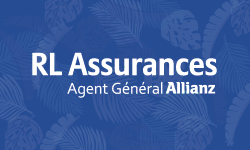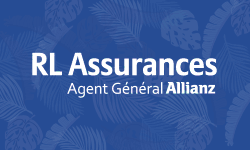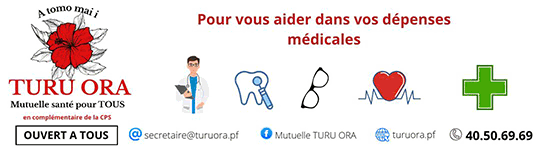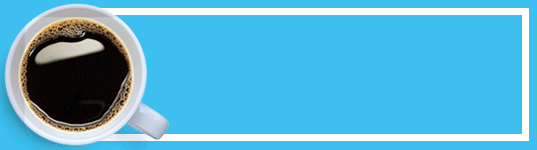Depuis trois ans, la DRM a infligé une centaine d’amendes de grande voirie à d’anciens perliculteurs pour n’avoir pas remis leur site de production en état, après leur cessation d’activité. Crédit photo : Archives TI.
Tahiti, le 5 février 2025 - Les contraventions de grande voirie visant les perliculteurs se sont multipliées ces dernières années. En cause : des manquements répétés à l'obligation légale de remise en état des sites après exploitation. Entre 2022 et 2024, près de 100 amendes ont été distribuées par la Direction des ressources marines (DRM) à des exploitants ayant abandonné filets, lignes d'élevages et autres équipements dans les lagons. Face à cette situation, la DRM a notamment mis en place des actions pour améliorer la gestion des déchets, tandis que les perliculteurs prennent de plus en plus conscience de l’impact de leur activité sur l’environnement.
Depuis quelques années, les contraventions de grande voirie pleuvent sur le secteur de la perliculture, ciblant plus précisément les fins d’exploitation négligées. En l’espace de trois ans, la Direction des ressources marines (DRM) a infligé près de 100 amendes à des exploitants pour défaut de remise en état de leurs sites, abandonnés sans ménagement pour les lagons une fois l'activité stoppée. Le constat est sans appel : 40 contraventions en 2022, 40 en 2023 et 20 en 2024. Lignes d'élevage, cordages, structures rouillées ou en béton de fare greffe : autant de déchets laissés à l'abandon, parfois au fond du lagon.
Pourtant, installées sur le domaine public maritime, les fermes perlières sont soumises à une obligation légale : restituer les sites exploités dans leur état originel, c’est-à-dire avant le démarrage de l'exploitation, dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité. Une exigence loin d'être anodine, puisqu'elle vise à préserver l'écosystème lagonaire.
Depuis quelques années, les contraventions de grande voirie pleuvent sur le secteur de la perliculture, ciblant plus précisément les fins d’exploitation négligées. En l’espace de trois ans, la Direction des ressources marines (DRM) a infligé près de 100 amendes à des exploitants pour défaut de remise en état de leurs sites, abandonnés sans ménagement pour les lagons une fois l'activité stoppée. Le constat est sans appel : 40 contraventions en 2022, 40 en 2023 et 20 en 2024. Lignes d'élevage, cordages, structures rouillées ou en béton de fare greffe : autant de déchets laissés à l'abandon, parfois au fond du lagon.
Pourtant, installées sur le domaine public maritime, les fermes perlières sont soumises à une obligation légale : restituer les sites exploités dans leur état originel, c’est-à-dire avant le démarrage de l'exploitation, dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité. Une exigence loin d'être anodine, puisqu'elle vise à préserver l'écosystème lagonaire.
Nouveaux outils de contrôle
Or, la réalité est tout autre. Beaucoup d'exploitants cessent leurs activités en laissant derrière eux les vestiges polluants d’années de perliculture. Fabien Tertre, chef adjoint de la cellule gestion et préservation des ressources de la DRM, dresse le constat : “Cela fait 12 ans que nous distribuons des contraventions de grande voirie. Au départ, nous étions focalisés sur les dépassements de superficie, car c'était la grande époque de la perle. On essayait juste d'éviter l'anarchie totale. Mais avec l'acquisition de nouveaux outils – drones aériens et sous-marins, GPS de précision, plongeurs spécialisés – nos contrôles sont devenus plus précis. C'est ainsi qu'après le Covid, quand le prix de la perle s'est effondré, de nombreuses exploitations ont fermé ou ont réduit leur superficie. Nous pensions parfois que les remises en état avaient été faites, mais lors de nos contrôles, en sondant les fonds lagonaires avec nos nouveaux outils, nous avons découvert que de nombreuses installations abandonnées n'avaient pas été totalement démantelées. C'est ce qui a provoqué les nombreuses contraventions distribués ces trois dernières années.” L'absence de prescription sur le domaine public permet à la DRM de sanctionner d’anciens exploitations plusieurs années après la cessation d’activité. Une négligence qui coûte cher à l'environnement… et désormais aux contrevenants.
Une facture salée
Chaque contravention se décompose en deux volets : une amende pénale, souvent de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs, et le remboursement des frais de remise en état. Ces frais incluent non seulement le démantèlement des structures abandonnées, mais aussi le coût de déplacement des agents de la DRM, des équipes de plongeurs, des navires logistiques et du matériel spécialisé.
Les interventions sont complexes et coûteuses. Il faut mobiliser des plongeurs professionnels pour récupérer des lignes d'élevage enchevêtrées à des profondeurs atteignant parfois 50 mètres. Les déchets solides – filets, collecteurs, bouées détruites, grillage, structures métalliques oxydées – doivent être transportés vers des centres de traitement à Tahiti. Et ce, à grands frais. “Certains exploitants se contentaient de couper les lignes d'élevage au niveau des bouées, les laissant couler au fond du lagon. Aller les récupérer, c'est très compliqué”, précise Fabien Tertre.
Or, la réalité est tout autre. Beaucoup d'exploitants cessent leurs activités en laissant derrière eux les vestiges polluants d’années de perliculture. Fabien Tertre, chef adjoint de la cellule gestion et préservation des ressources de la DRM, dresse le constat : “Cela fait 12 ans que nous distribuons des contraventions de grande voirie. Au départ, nous étions focalisés sur les dépassements de superficie, car c'était la grande époque de la perle. On essayait juste d'éviter l'anarchie totale. Mais avec l'acquisition de nouveaux outils – drones aériens et sous-marins, GPS de précision, plongeurs spécialisés – nos contrôles sont devenus plus précis. C'est ainsi qu'après le Covid, quand le prix de la perle s'est effondré, de nombreuses exploitations ont fermé ou ont réduit leur superficie. Nous pensions parfois que les remises en état avaient été faites, mais lors de nos contrôles, en sondant les fonds lagonaires avec nos nouveaux outils, nous avons découvert que de nombreuses installations abandonnées n'avaient pas été totalement démantelées. C'est ce qui a provoqué les nombreuses contraventions distribués ces trois dernières années.” L'absence de prescription sur le domaine public permet à la DRM de sanctionner d’anciens exploitations plusieurs années après la cessation d’activité. Une négligence qui coûte cher à l'environnement… et désormais aux contrevenants.
Une facture salée
Chaque contravention se décompose en deux volets : une amende pénale, souvent de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs, et le remboursement des frais de remise en état. Ces frais incluent non seulement le démantèlement des structures abandonnées, mais aussi le coût de déplacement des agents de la DRM, des équipes de plongeurs, des navires logistiques et du matériel spécialisé.
Les interventions sont complexes et coûteuses. Il faut mobiliser des plongeurs professionnels pour récupérer des lignes d'élevage enchevêtrées à des profondeurs atteignant parfois 50 mètres. Les déchets solides – filets, collecteurs, bouées détruites, grillage, structures métalliques oxydées – doivent être transportés vers des centres de traitement à Tahiti. Et ce, à grands frais. “Certains exploitants se contentaient de couper les lignes d'élevage au niveau des bouées, les laissant couler au fond du lagon. Aller les récupérer, c'est très compliqué”, précise Fabien Tertre.
Dans les faits, la DRM mets en demeure les anciens concessionnaires de remettre leur ancien site en état avant l'action en justice. 90% d'entre eux choisissent cette option. “Ils préfèrent le faire, car souvent, ils ne prennent qu'un plongeur, alors que la réglementation en oblige trois. Nous, on se cale sur la règlementation, et ça coûte plus cher pour eux au final. C'est aussi pour ces raisons que les montants de nos contraventions sont aussi importants.”
Défaillances et responsabilités
Mais alors, pourquoi tant de fermes n'assurent-elles pas la remise en état de leurs sites ? Fabien Tertre épingle soit le “manque de moyens” et soit le “laxisme”. Maeva Wane, perlicultrice à Ahe et signataire de la charte des bonnes pratiques perlicoles (une charte adoptée en 2022 qui ne regroupe que trois adhérents pour l'instant) se montre plus sévère : “Normalement le perliculteur a les moyens de payer [...]. Mais souvent les exploitants préfèrent investir dans des supers moteurs et de belles bagnoles plutôt que de financer la gestion des déchets avec des tracteurs, ou embaucher des gars. C'est une mauvaise gestion et du je-m'en-foutisme.”
Les déchets laissés derrière – cordages, collecteurs, bouées brisées, filets, grillages – sont à 90% en plastique, un matériau dont la dégradation est lente et les impacts environnementaux durables. Depuis 2022, un plan de gestion des déchets est requis pour toute nouvelle demande d'ouverture de ferme perlière, mais celui-ci n'inclut généralement pas la fin d'exploitation. “Quand on ouvre une entreprise, on ne pense pas forcément à la fin”, explique Fabien Tertre. “On a pensé, un temps, mettre en place une caution environnementale, qui bloquerait une somme d'argent, pour le cas où l'entreprise ne remettrait pas en état son site d’exploitation à son départ des lieux.”
Défaillances et responsabilités
Mais alors, pourquoi tant de fermes n'assurent-elles pas la remise en état de leurs sites ? Fabien Tertre épingle soit le “manque de moyens” et soit le “laxisme”. Maeva Wane, perlicultrice à Ahe et signataire de la charte des bonnes pratiques perlicoles (une charte adoptée en 2022 qui ne regroupe que trois adhérents pour l'instant) se montre plus sévère : “Normalement le perliculteur a les moyens de payer [...]. Mais souvent les exploitants préfèrent investir dans des supers moteurs et de belles bagnoles plutôt que de financer la gestion des déchets avec des tracteurs, ou embaucher des gars. C'est une mauvaise gestion et du je-m'en-foutisme.”
Les déchets laissés derrière – cordages, collecteurs, bouées brisées, filets, grillages – sont à 90% en plastique, un matériau dont la dégradation est lente et les impacts environnementaux durables. Depuis 2022, un plan de gestion des déchets est requis pour toute nouvelle demande d'ouverture de ferme perlière, mais celui-ci n'inclut généralement pas la fin d'exploitation. “Quand on ouvre une entreprise, on ne pense pas forcément à la fin”, explique Fabien Tertre. “On a pensé, un temps, mettre en place une caution environnementale, qui bloquerait une somme d'argent, pour le cas où l'entreprise ne remettrait pas en état son site d’exploitation à son départ des lieux.”
La pollution plastique, un enjeu majeur
D'autant que les conséquences environnementales sont loin d'être anodines. La DRM a d'ailleurs transmis en 2023 plusieurs dossiers à l'Oclaesp, la cellule de la gendarmerie spécialisée dans les atteintes à l'environnement. Des signalements qui ont abouti à des condamnations pour atteinte à l'environnement. Loanah Wong, responsable de la cellule innovation et valorisation en perliculture à la DRM, explique : “Des études réalisées entre 2015 et 2024 montrent que les microplastiques issus des installations perlières affectent la qualité de vie du lagon et la qualité des perles, in fine.”
Bien que le sujet demeure délicat et sensible, en particulier sur le plan des échanges commerciaux internationaux, Fabien Tertre l'admet : “La production de perle utilise beaucoup de plastique, d’essence et d’huile. En matière de durabilité, ce n'est pas le mieux.”
Vers une perliculture plus responsable
Tout n'est pas si sombre pour autant ; et l'idée n'est pas d'associer les termes perlicultures et pollueurs. Car même si l'activité perlicole pollue – comme c'est le cas avec l'abandon des fermes sans dépollution – la prise de conscience avance chez les exploitants. “Beaucoup d'efforts ont été réalisés, ce n'est pas comme à l'époque, il y a une vraie volonté d'évoluer”, explique Maeva Wane. La DRM a notamment engagé des initiatives notables dans ce sens, favorisant ce déclic. En 2021, un programme de collecte et de rapatriement des déchets vers Tahiti a été lancé, couvrant une douzaine d'îles perlicoles. “Ça a tellement bien marché que certaines communes veulent inspirer de notre méthode pour leur gestion des déchets ménager”, explique Loanah Wong.
D'autant que les conséquences environnementales sont loin d'être anodines. La DRM a d'ailleurs transmis en 2023 plusieurs dossiers à l'Oclaesp, la cellule de la gendarmerie spécialisée dans les atteintes à l'environnement. Des signalements qui ont abouti à des condamnations pour atteinte à l'environnement. Loanah Wong, responsable de la cellule innovation et valorisation en perliculture à la DRM, explique : “Des études réalisées entre 2015 et 2024 montrent que les microplastiques issus des installations perlières affectent la qualité de vie du lagon et la qualité des perles, in fine.”
Bien que le sujet demeure délicat et sensible, en particulier sur le plan des échanges commerciaux internationaux, Fabien Tertre l'admet : “La production de perle utilise beaucoup de plastique, d’essence et d’huile. En matière de durabilité, ce n'est pas le mieux.”
Vers une perliculture plus responsable
Tout n'est pas si sombre pour autant ; et l'idée n'est pas d'associer les termes perlicultures et pollueurs. Car même si l'activité perlicole pollue – comme c'est le cas avec l'abandon des fermes sans dépollution – la prise de conscience avance chez les exploitants. “Beaucoup d'efforts ont été réalisés, ce n'est pas comme à l'époque, il y a une vraie volonté d'évoluer”, explique Maeva Wane. La DRM a notamment engagé des initiatives notables dans ce sens, favorisant ce déclic. En 2021, un programme de collecte et de rapatriement des déchets vers Tahiti a été lancé, couvrant une douzaine d'îles perlicoles. “Ça a tellement bien marché que certaines communes veulent inspirer de notre méthode pour leur gestion des déchets ménager”, explique Loanah Wong.
Des recherches sont également en cours sur des matériaux plus durables, comme les fibres naturelles ou des plastiques biodégradables. “Paradoxalement, même des exploitants ayant déjà été sanctionnés sont volontaires pour tester ces nouveaux matériaux. Tout le monde a conscience qu'une activité moins polluante est bénéfique”, note Fabien Tertre.
Enfin, la récente mise à jour règlementaire imposant un quota de production de perle maximal par hectare tout en limitant la superficie par exploitation et par îles, est conçue pour limiter les abus. “Nous ne retomberons pas dans les travers d'avant. Nous ne distribuerons plus 50 contraventions comme en 2022.” D'autant que désormais, les fermes sont redevenues à taille humaine, loin des superstructures de plus de 200 hectares d'autrefois.
Enfin, la récente mise à jour règlementaire imposant un quota de production de perle maximal par hectare tout en limitant la superficie par exploitation et par îles, est conçue pour limiter les abus. “Nous ne retomberons pas dans les travers d'avant. Nous ne distribuerons plus 50 contraventions comme en 2022.” D'autant que désormais, les fermes sont redevenues à taille humaine, loin des superstructures de plus de 200 hectares d'autrefois.