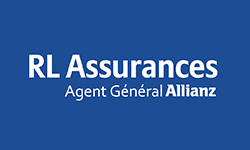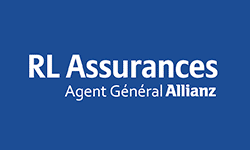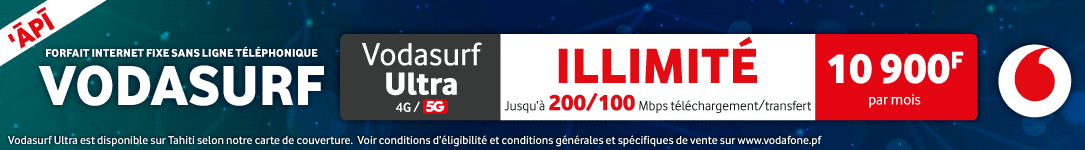Tahiti, le 17 décembre 2025 - Bruno Rasmussen, titulaire d’un master en biologie intégrative évolutive (depuis 2016), vient de démarrer une thèse avec AOA Polynesian Forests et l’école doctorale Divona du Museum national d’histoire naturelle de Paris qui vise à étudier les microlépidoptères polynésiens. L’objectif ? Fournir des outils pour, entre autres, mener à bien des projets d’écologie de la conservation et de la restauration.
Il a démarré ses travaux au mois d’octobre. Bruno Rasmussen parcourt le milieu forestier de Tahiti pour étudier les papillons. Suivant différents protocoles de prélèvement, il piège des papillons allant de 5 mm à 6 cm. Il travaille le jour et la nuit pour, dans un premier temps, “récolter le matériel”. Ensuite, il aura à identifier les espèces ainsi que de décrire et nommer certaines espèces nouvelles pour la science.
Bruno Rasmussen a étudié la biologie intégrative, il a obtenu un master à Lille. La biologie intégrative est un domaine scientifique qui combine des approches de plusieurs disciplines pour comprendre les systèmes biologiques dans leur ensemble. Il vient de démarrer une thèse sur les microlépidoptères du Fenua (voir encadré) avec AOA Polynesian Forests et l’école doctorale Divona du Museum national d’histoire naturelle de Paris. Il va, pendant trois ans, réaliser un travail de taxonomiste et travailler en écologie de la conservation et de la restauration. “Ma thèse va fournir des outils”, résume-t-il.
La conservation de la biodiversité passe notamment par la mise en place de dispositifs de protection de la faune et de la flore et de leurs habitats en créant par exemple des parcs, réserves naturelles ou aires protégées. La restauration, elle, est un ensemble de pratiques mises en place sur des milieux dégradés qui visent à restaurer la biodiversité, le bon état écologique… Ce que fait AOA Polynesian Forests pour les forêts locales sur la côte ouest de Tahiti.
Un métier en voie de disparition
Le taxonomiste est celui “qui dessine les limites entre chaque espèce”, il décrit chaque espèce, les nomme. À l’image d’un historien, à l’aide de livres et en s’appuyant sur des archives de différents musées et notamment ceux de Londres, Paris, Hawaii et Washington, Bruno Rasmussen va vérifier les noms de toutes les espèces rencontrées. “Le naturaliste identifie les espèces, le taxonomiste – qui est un métier en voie de disparition” – regrette le doctorant, “remet le nom sur les espèces”. Pour cela, il s’appuie sur la morphologie, la distribution géographique et l’analyse ADN.
Aucune démarche de ce genre n’a été encore été menée dans l’archipel de la Société pour les microlépidoptères. La dernière espèce décrite en Polynésie remonte à 1930, elle l’a été par l’Anglais Edward Meyrick. “Il en a décrit des milliers dans le monde”, précise Bruno Rasmussen. Gates Clarke a, dans les années 1970-1980, effectué un travail de taxonomiste sur ces espèces aux Marquises et à Rapa. “C’est une base”, reconnaît le doctorant, mais la tâche reste considérable.
En Polynésie, environ 600 espèces de microlépidoptères ont déjà été identifiées, il en existerait sans doute le double. Pour les premières, il est important de vérifier et compléter ce qui a déjà été fait ; pour les autres, il faudra alors effectuer un travail de description. “Le bon nom d’une espèce est celui qui a été donné par la personne qui l'a décrite en premier”, précise Bruno Rasmussen. Ensuite, il arrive que certaines espèces écopent de plus de deux noms. “Il y a eu beaucoup de confusion au cours des deux derniers siècles.” Par exemple, des chercheurs travaillant en différents lieux ont pu attribuer un nom différent à une même espèce.
Mais avant de monter des projets de conservation et de restauration, et après la phase de taxonomie, Bruno Rasmussen aura à vérifier que les microlepidoptères sont de bons bio-indicateurs pour l’écologie de la conservation et de la restauration. “Nous le supposons pour l’instant et nous avons pu le vérifier pour le réchauffement climatique par exemple, la pollution, l’écologie de la conservation ou l’aménagement forestier, mais il faut encore le prouver pour l’écologie de la restauration”, précise Bruno Rasmussen.
Pour mettre en place des mesures, encore faut-il connaître les espèces qui y vivent, leur mode de vie et les liens qu’elles tissent entre elles. La recherche, souvent confidentielle, reste donc cruciale et indispensable étant donné les enjeux environnementaux qui pèsent sur la planète.
Il a démarré ses travaux au mois d’octobre. Bruno Rasmussen parcourt le milieu forestier de Tahiti pour étudier les papillons. Suivant différents protocoles de prélèvement, il piège des papillons allant de 5 mm à 6 cm. Il travaille le jour et la nuit pour, dans un premier temps, “récolter le matériel”. Ensuite, il aura à identifier les espèces ainsi que de décrire et nommer certaines espèces nouvelles pour la science.
Bruno Rasmussen a étudié la biologie intégrative, il a obtenu un master à Lille. La biologie intégrative est un domaine scientifique qui combine des approches de plusieurs disciplines pour comprendre les systèmes biologiques dans leur ensemble. Il vient de démarrer une thèse sur les microlépidoptères du Fenua (voir encadré) avec AOA Polynesian Forests et l’école doctorale Divona du Museum national d’histoire naturelle de Paris. Il va, pendant trois ans, réaliser un travail de taxonomiste et travailler en écologie de la conservation et de la restauration. “Ma thèse va fournir des outils”, résume-t-il.
La conservation de la biodiversité passe notamment par la mise en place de dispositifs de protection de la faune et de la flore et de leurs habitats en créant par exemple des parcs, réserves naturelles ou aires protégées. La restauration, elle, est un ensemble de pratiques mises en place sur des milieux dégradés qui visent à restaurer la biodiversité, le bon état écologique… Ce que fait AOA Polynesian Forests pour les forêts locales sur la côte ouest de Tahiti.
Un métier en voie de disparition
Le taxonomiste est celui “qui dessine les limites entre chaque espèce”, il décrit chaque espèce, les nomme. À l’image d’un historien, à l’aide de livres et en s’appuyant sur des archives de différents musées et notamment ceux de Londres, Paris, Hawaii et Washington, Bruno Rasmussen va vérifier les noms de toutes les espèces rencontrées. “Le naturaliste identifie les espèces, le taxonomiste – qui est un métier en voie de disparition” – regrette le doctorant, “remet le nom sur les espèces”. Pour cela, il s’appuie sur la morphologie, la distribution géographique et l’analyse ADN.
Aucune démarche de ce genre n’a été encore été menée dans l’archipel de la Société pour les microlépidoptères. La dernière espèce décrite en Polynésie remonte à 1930, elle l’a été par l’Anglais Edward Meyrick. “Il en a décrit des milliers dans le monde”, précise Bruno Rasmussen. Gates Clarke a, dans les années 1970-1980, effectué un travail de taxonomiste sur ces espèces aux Marquises et à Rapa. “C’est une base”, reconnaît le doctorant, mais la tâche reste considérable.
En Polynésie, environ 600 espèces de microlépidoptères ont déjà été identifiées, il en existerait sans doute le double. Pour les premières, il est important de vérifier et compléter ce qui a déjà été fait ; pour les autres, il faudra alors effectuer un travail de description. “Le bon nom d’une espèce est celui qui a été donné par la personne qui l'a décrite en premier”, précise Bruno Rasmussen. Ensuite, il arrive que certaines espèces écopent de plus de deux noms. “Il y a eu beaucoup de confusion au cours des deux derniers siècles.” Par exemple, des chercheurs travaillant en différents lieux ont pu attribuer un nom différent à une même espèce.
Mais avant de monter des projets de conservation et de restauration, et après la phase de taxonomie, Bruno Rasmussen aura à vérifier que les microlepidoptères sont de bons bio-indicateurs pour l’écologie de la conservation et de la restauration. “Nous le supposons pour l’instant et nous avons pu le vérifier pour le réchauffement climatique par exemple, la pollution, l’écologie de la conservation ou l’aménagement forestier, mais il faut encore le prouver pour l’écologie de la restauration”, précise Bruno Rasmussen.
Pour mettre en place des mesures, encore faut-il connaître les espèces qui y vivent, leur mode de vie et les liens qu’elles tissent entre elles. La recherche, souvent confidentielle, reste donc cruciale et indispensable étant donné les enjeux environnementaux qui pèsent sur la planète.