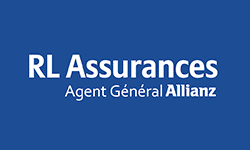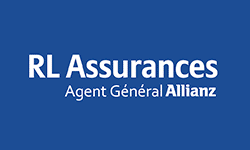Le Professeur Charles-Edouard Luyt et le Dr Thibaut Schoell, de l'hôpital de la Pitié Salpétrière et le Dr Eric Bonnieux, de l'hôpital du Taaone.
Papeete, le 8 février 2018 - Deux médecins de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris sont actuellement en Polynésie afin de dispenser une formation d'une semaine dans le cadre d’un diplôme universitaire sur une technique de circulation extra corporelle complexe. Cette technique, appelée Ecmo, vise à suppléer pendant plusieurs jours ou semaines la fonction respiratoire et/ou cardiaque de patients très graves, qui seraient sinon condamnés.
"Depuis 2011, nous avons déjà pratiqué 38 Ecmo à l'hôpital, dont onze en 2017. Cette activité monte en puissance ces dernières années", explique le Dr Eric Bonnieux, du service de Réanimation du Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF), responsable de l'Ecmo (oxygénation extracorporelle sur membrane) jeudi lors de la présentation du diplôme universitaire (DU) consacré à cette technique. Ce DU est dispensé par deux experts de l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, le Professeur Charles-Edouard Luyt et le Dr Thibaut Schoell.
En tout, ce sont 28 personnes, médecins et infirmières exerçant principalement à l'hôpital en réanimation et en cardiologie, mais également un médecin d'Europ Assistance qui participent à ce DU dispensé en deux sessions, dont la première se déroule actuellement à Tahiti. La seconde est programmée au début du mois de juin prochain. A noter, que parmi les participants, trois médecins calédoniens suivent également cette formation en direct par vidéo conférence.
Cette technique de l'Ecmo est mise en place pour des malades très graves. C'est une technique de circulation extracorporelle qui permet de suppléer aux défaillances cardiaques et/ou respiratoires d’un patient en assurant le débit circulatoire nécessaire et l’oxygénation. Cette technique peut fournir une assistance partielle ou complète. La mise en place de l’Ecmo se fait de façon percutanée au lit du patient.
"Actuellement, quatre médecins de réanimation sont déjà formés en Polynésie à cette technique complexe et deux infirmiers, ce DU doit permettre d'augmenter le nombre de personnes capable de mettre en place cette technique", souligne le Dr Éric Bonnieux qui souhaiterait à terme pouvoir instaurer un système d'astreinte pour l'Ecmo.
"Depuis 2011, nous avons déjà pratiqué 38 Ecmo à l'hôpital, dont onze en 2017. Cette activité monte en puissance ces dernières années", explique le Dr Eric Bonnieux, du service de Réanimation du Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF), responsable de l'Ecmo (oxygénation extracorporelle sur membrane) jeudi lors de la présentation du diplôme universitaire (DU) consacré à cette technique. Ce DU est dispensé par deux experts de l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, le Professeur Charles-Edouard Luyt et le Dr Thibaut Schoell.
En tout, ce sont 28 personnes, médecins et infirmières exerçant principalement à l'hôpital en réanimation et en cardiologie, mais également un médecin d'Europ Assistance qui participent à ce DU dispensé en deux sessions, dont la première se déroule actuellement à Tahiti. La seconde est programmée au début du mois de juin prochain. A noter, que parmi les participants, trois médecins calédoniens suivent également cette formation en direct par vidéo conférence.
Cette technique de l'Ecmo est mise en place pour des malades très graves. C'est une technique de circulation extracorporelle qui permet de suppléer aux défaillances cardiaques et/ou respiratoires d’un patient en assurant le débit circulatoire nécessaire et l’oxygénation. Cette technique peut fournir une assistance partielle ou complète. La mise en place de l’Ecmo se fait de façon percutanée au lit du patient.
"Actuellement, quatre médecins de réanimation sont déjà formés en Polynésie à cette technique complexe et deux infirmiers, ce DU doit permettre d'augmenter le nombre de personnes capable de mettre en place cette technique", souligne le Dr Éric Bonnieux qui souhaiterait à terme pouvoir instaurer un système d'astreinte pour l'Ecmo.
METTRE LES ORGANES AU REPOS

Une évasan sous Ecmo. Crédit Pitié Salpêtrière.
L’Ecmo n’est pas un traitement curatif, elle permet de mettre au repos sur une période de plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines les organes défaillantes. Dans la très grande majorité des cas, ce repos aide à la récupération du fonctionnement des organes (cœur ou poumon). La mise en place d’une telle technique est lourde.
"Nous avons observé des bonnes indications ici d'Ecmo avec des résultats de 40% qui sont plutôt satisfaisants. L'une des difficultés de cette technique est la sélection du patient sur laquelle elle peut être utilisée et à quel moment. Le timing est très important car si cette technique est utilisée trop tard, les organes peuvent déjà être bien endommagés. Ce n'est pas évident. Nous partageons notre expérience car nous réalisons environ 400 Ecmo à la Pitié", explique le Professeur Charles-Edouard Luyt.
Parfois, dans de rares cas, il arrive que "la mise en repos des organes ne suffise pas, la seule solution alors pour sauver ces patients est de les adresser dans un centre de référence en vue d’une transplantation cardiaque ou de la mise en place d’une assistance cardiaque prolongée (cœur artificiel) ", explique le Dr Bonnieux. Concrètement, cela signifie que l'Ecmo est utilisée afin de gagner du temps, et que la personne doit être évasanée sous Ecmo à Paris à la Pitié Salpêtrière si elle veut avoir des chances de survivre, puisque le CHPF ne pratique pas de transplantation. "Il n'est pas possible d'envoyer des patients en Nouvelle-Zélande, pourtant bien plus près, car un patient ne peut se faire greffer dans un pays étranger si la pratique de la greffe existe déjà dans son pays", explique le Dr Thibaut Schoell.
"Nous avons observé des bonnes indications ici d'Ecmo avec des résultats de 40% qui sont plutôt satisfaisants. L'une des difficultés de cette technique est la sélection du patient sur laquelle elle peut être utilisée et à quel moment. Le timing est très important car si cette technique est utilisée trop tard, les organes peuvent déjà être bien endommagés. Ce n'est pas évident. Nous partageons notre expérience car nous réalisons environ 400 Ecmo à la Pitié", explique le Professeur Charles-Edouard Luyt.
Parfois, dans de rares cas, il arrive que "la mise en repos des organes ne suffise pas, la seule solution alors pour sauver ces patients est de les adresser dans un centre de référence en vue d’une transplantation cardiaque ou de la mise en place d’une assistance cardiaque prolongée (cœur artificiel) ", explique le Dr Bonnieux. Concrètement, cela signifie que l'Ecmo est utilisée afin de gagner du temps, et que la personne doit être évasanée sous Ecmo à Paris à la Pitié Salpêtrière si elle veut avoir des chances de survivre, puisque le CHPF ne pratique pas de transplantation. "Il n'est pas possible d'envoyer des patients en Nouvelle-Zélande, pourtant bien plus près, car un patient ne peut se faire greffer dans un pays étranger si la pratique de la greffe existe déjà dans son pays", explique le Dr Thibaut Schoell.
UNE EVASAN SOUS ECMO DE 24 HEURES
A l'heure actuelle, des evasan sous Ecmo sont déjà effectuées aux Antilles ou à La Réunion, mais les trajets avoisinent les 12 heures, les 24 heures de trajet entre Tahiti et Paris demande une lourde et coûteuse logistique.
"On réfléchit avec l'équipe de réanimation ici, il y a encore des problèmes à régler du fait de l'éloignement. Ce long trajet engendre différents problèmes techniques et logistiques notamment concernant le transport d'oxygène, car l'Ecmo nécessite une grande consommation d'oxygène. On espère que cela pourra se régler assez rapidement. Une fois le malade dans l'avion, il reste un patient de réanimation avec deux médecins et deux infirmiers pour d'occuper de lui, c'est assez rare. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait plus d’événements dans l'avion que dans un service de réanimation", remarque le Dr Thibaut Schoell, qui a déjà à son actif une dizaine d'evasan sous Ecmo avec les Antilles.
"Nous sommes actuellement en discussion avec la CPS, car le coût d'une telle evasan est élevé, et avec la compagnie Air Tahiti Nui, nous espérons que d'ici la fin de 2018, toutes les conditions soient réunies pour effectuer une evasan sous Ecmo vers Paris. Nous souhaitons donner aux Polynésiens les mêmes chances qu'ailleurs", conclut le Dr Éric Bonnieux.
"On réfléchit avec l'équipe de réanimation ici, il y a encore des problèmes à régler du fait de l'éloignement. Ce long trajet engendre différents problèmes techniques et logistiques notamment concernant le transport d'oxygène, car l'Ecmo nécessite une grande consommation d'oxygène. On espère que cela pourra se régler assez rapidement. Une fois le malade dans l'avion, il reste un patient de réanimation avec deux médecins et deux infirmiers pour d'occuper de lui, c'est assez rare. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait plus d’événements dans l'avion que dans un service de réanimation", remarque le Dr Thibaut Schoell, qui a déjà à son actif une dizaine d'evasan sous Ecmo avec les Antilles.
"Nous sommes actuellement en discussion avec la CPS, car le coût d'une telle evasan est élevé, et avec la compagnie Air Tahiti Nui, nous espérons que d'ici la fin de 2018, toutes les conditions soient réunies pour effectuer une evasan sous Ecmo vers Paris. Nous souhaitons donner aux Polynésiens les mêmes chances qu'ailleurs", conclut le Dr Éric Bonnieux.
Deux types d'Ecmo :
ECMO VV assistance respiratoire, en cas d’oxygénation insuffisante (hypoxémie) réfractaire, elle représente environ 2/3 des Ecmo réalisé en CHPF.
ECMO VA assistance cardio-respiratoire en cas de défaillance cardiaque (choc cardiogénique) réfractaire, elle représente environ 1/3 des Ecmo réalisé en CHPF.
ECMO VV assistance respiratoire, en cas d’oxygénation insuffisante (hypoxémie) réfractaire, elle représente environ 2/3 des Ecmo réalisé en CHPF.
ECMO VA assistance cardio-respiratoire en cas de défaillance cardiaque (choc cardiogénique) réfractaire, elle représente environ 1/3 des Ecmo réalisé en CHPF.